La télémédecine dans le contexte d’un pays sous-développé comme Haïti
La télémédecine a le potentiel d’améliorer considérablement l’accès aux soins de santé dans les pays en développement comme Haïti. Voici quelques points clés à considérer :
1. Accès aux spécialistes : La télémédecine permet de mettre en relation les patients des zones reculées avec des spécialistes médicaux qui ne sont pas forcément disponibles localement. Ceci est crucial pour les pathologies nécessitant des connaissances spécialisées.
2. Rentabilité : Elle permet de réduire les coûts et les délais de transport des patients, rendant ainsi les soins de santé plus abordables et accessibles.
3. Soins rapides : Les patients peuvent bénéficier de conseils et de consultations médicales sans avoir à attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous, ce qui est souvent le cas dans les systèmes de santé aux ressources limitées.
4. Formation et éducation : La télémédecine peut faciliter la formation des prestataires de soins de santé locaux grâce à des ateliers virtuels et à l’accès aux ressources, améliorant ainsi la qualité globale des soins.
5. Initiatives de santé publique : Elle peut également servir à l’éducation et à la sensibilisation en matière de santé publique, contribuant ainsi à faire connaître les mesures préventives et les ressources en matière de santé.
6. Défis : Cependant, des difficultés telles que la mauvaise connectivité, le manque d’infrastructures et une maîtrise limitée des technologies peuvent entraver la mise en œuvre de la télémédecine. Il est essentiel de relever ces défis pour une intégration efficace au système de santé.
Ayant participé à trois missions médicales en Haïti, je peux témoigner des problèmes mentionnés ci-dessus.
Mon expérience personnelle lors de ces missions dans la région des Cayes illustre les défis et le potentiel de la télémédecine dans de tels contextes. Examinons de plus près les arguments que j’ai mentionnés, compte tenu des circonstances spécifiques du sud d’Haïti.
1. Accès accru aux spécialistes : Dans les zones rurales comme celles du sud d’Haïti, il peut être difficile pour les patients d’accéder à des spécialistes en raison des barrières géographiques et des ressources sanitaires locales limitées. Je me souviens d’un enfant de 10 ans qui avait une fracture à l’avant-bras. Nous avons fait de notre mieux pour poser une attelle et avons rapidement organisé l’orientation de l’enfant vers les Cayes, où se trouve l’hôpital principal. Certains d’entre nous ont collecté des fonds pour financer le transport des parents. C’était un jeudi après-midi ; notre départ était prévu le lendemain matin. La mère de l’enfant nous avait promis qu’elle ferait tout son possible pour emmener l’enfant aux Cayes cet après-midi-là. À notre grande surprise, nous avons tous vu la mère faire la queue 12 heures plus tard le lendemain : elle attendait avec impatience le médecin qui poserait le plâtre.
La télémédecine pourrait combler ce manque en mettant les patients en contact avec des spécialistes grâce à des consultations virtuelles. Par exemple, si un patient a besoin de soins orthopédiques après une blessure, il pourrait bénéficier d’une consultation vidéo avec un spécialiste à Port-au-Prince ou même à l’étranger, ce qui permettrait des interventions rapides qui seraient autrement impossibles.
2. Rentabilité : Se déplacer pour se faire soigner entraîne souvent des coûts importants, surtout dans les régions reculées où les moyens de transport sont limités et coûteux. Grâce à la télémédecine, les patients peuvent économiser sur les frais de déplacement et gagner du temps, ce qui leur permet de se concentrer sur les traitements ou les médicaments nécessaires. Ceci est particulièrement important dans les régions où les ménages sont déjà confrontés à des difficultés financières, car cela peut contribuer à alléger le fardeau des coûts de santé. Une autre expérience m’a marqué : j’ai pratiqué une biopsie sur une femme présentant des signes évidents de cancer du sein. J’ai parlé au directeur de l’hôpital, qui m’a conseillé de remettre l’échantillon à la patiente, qui l’apporterait elle-même au laboratoire pour confirmation du diagnostic. Deux semaines plus tard, j’ai appelé des États-Unis pour un suivi. On m’a dit que la femme ne s’était pas présentée pour le retrait de ses points de suture et qu’on ne savait pas ce qu’elle avait fait de l’échantillon de laboratoire, qui était fortement suspect de cancer du sein.
Être choqué de manière émotionnelle par les agissements spectaculaires, criminels des bandits est une chose. Qu’en est-il de ceux ou celles qui meurent lentement, comme cette femme qui, j’en suis sûr, va mourir d’une maladie métastatique dans environ cinq ou six mois ? Parce qu’elle ne trouvera pas, parmi tant d’autres, de soins adéquats dans une société hypocrite, égoïste, voire cruelle.
Les « massacres » lents, quotidiens et inévitables causés par les maladies d’une part et les morts rapides et spectaculaires des bandits, voire les massacres perpétrés par eux d’autre part, sont à peu près identiques, car ils conduisent tous deux à la fin de la vie des gens ; à mon avis, d’un point de vue moral, ils sont identiques, car dans le cas de ces morts lentes de la population, il n’y pas de justifications morales du côté de nos dirigeants.
Trêve de digression !
3. Soins rapides : Les longs délais d’attente pour les rendez-vous peuvent être la norme dans de nombreux systèmes de santé, y compris en Haïti. La télémédecine offre un accès plus rapide aux conseils et aux soins médicaux, ce qui est essentiel pour les problèmes de santé urgents. Par exemple, un patient présentant des symptômes graves peut obtenir un rendez-vous virtuel en quelques jours au lieu d’attendre des semaines pour une consultation en personne. Cette immédiateté peut améliorer les résultats pour les patients, en particulier dans les cas où une intervention précoce est essentielle. Vous souvenez-vous de notre enfant au bras cassé mentionné plus haut ?
4. Formation et éducation : La télémédecine peut être un outil puissant pour la formation continue des prestataires de soins de santé locaux. En organisant des ateliers et des séminaires virtuels, les professionnels de santé du sud d’Haïti peuvent apprendre auprès de professionnels expérimentés du monde entier sans avoir à se déplacer. Cela pourrait contribuer à améliorer la qualité des soins dispensés localement, les praticiens acquérant de nouvelles compétences et connaissances adaptées aux besoins de leur communauté.
5. Initiatives de santé publique : La télémédecine peut également influencer considérablement l’éducation sanitaire et les initiatives de santé publique. Grâce à la possibilité de diffuser rapidement et efficacement des informations via des plateformes numériques, les autorités sanitaires locales peuvent fournir des informations essentielles sur la prévention des maladies, les programmes de vaccination et les ressources sanitaires. Cette sensibilisation peut permettre aux communautés de prendre des mesures proactives pour protéger leur santé.
6. Défis : Malgré ses avantages, la mise en œuvre de la télémédecine dans le sud d’Haïti présente des défis considérables. Comme mentionné précédemment, la mauvaise connectivité internet dans les zones rurales peut fortement limiter l’accès à ces services.
Certains membres de notre équipe ont déboursé des sommes considérables pour parler à leurs proches restés aux États-Unis.
De plus, les infrastructures peuvent être limitées, comme le manque d’électricité ou d’appareils pour les patients. De plus, les connaissances technologiques varient considérablement au sein de la population, ce qui peut freiner l’adoption de solutions de télémédecine. Relever ces défis nécessitera un effort concerté impliquant les partenaires gouvernementaux et privés afin d’améliorer les infrastructures et de dispenser une formation à l’utilisation des technologies de télésanté.
Mon expérience en Haïti lors de mes missions médicales m’a permis de mieux comprendre comment relever ces défis et développer les solutions de télémédecine en Haïti. Si vous souhaitez explorer des stratégies spécifiques ou des exemples d’initiatives de télémédecine réussies que vous avez rencontrées, n’hésitez pas à me contacter !
Carl Gilbert, MD, FACS
Radio Francophonie Connexion Santé


Une mission de santé aux Cayes, Haïti
Share this content:
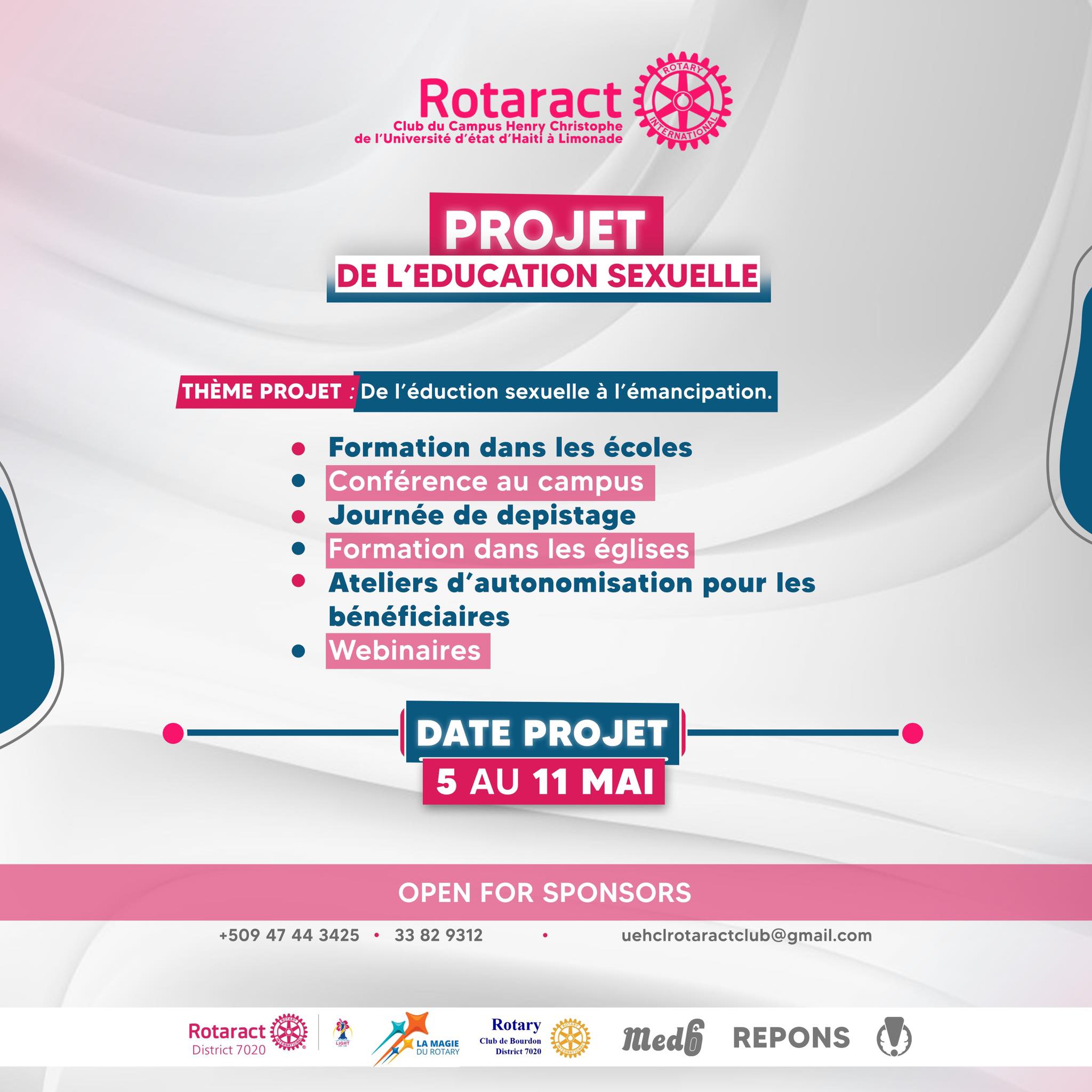








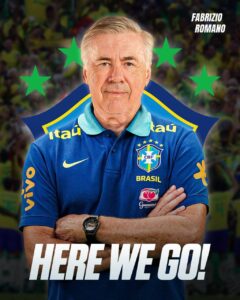


Laisser un commentaire